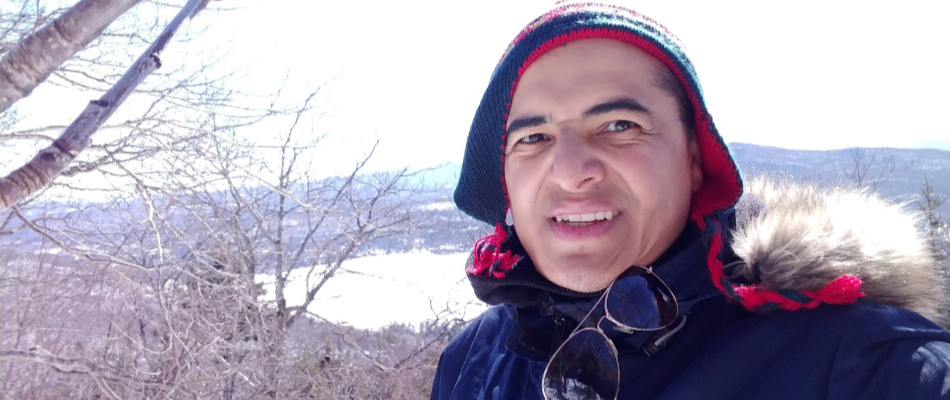Le Québec, c’était un projet de couple. Mais, en 2009, c’est seul que Diego est arrivé de Colombie. Il a fallu 7 ans de bataille pour que son conjoint puisse enfin le rejoindre. Un vécu dans les marges qui a aiguisé la conscience de ce spécialiste en droits humains.
En Colombie, le visa canadien fait partie des plus difficiles à obtenir. Diego a 31 ans en 2009, il est alors professeur et chercheur à l’université Saint-Thomas de Bogotá. Il ne pense qu’à une chose, « sortir du pays » en reprenant des études pour échapper à la dureté des conditions de vie. Attiré par le Canada pour son bilinguisme, Diego réussit à rassembler la somme de 13 000 $ CAN demandée pour un visa d’étudiant étranger. « C’est comme ça que mon immigration a commencé. Malheureusement, cela a aussi marqué le début de ma séparation », raconte-t-il. En arrivant à Montréal le 26 août 2009, Diego laisse derrière lui son conjoint, avec qui il est engagé par un « pacte colombien ». À l’époque, le mariage pour les couples de même sexe n’est pas autorisé en Colombie. « On était convenu avec mon chum qu’il me rejoindrait quelques mois plus tard, quand je serais installé et que nous aurions réuni la somme d’argent nécessaire pour son visa ». En janvier 2010, Diego dépose un dossier pour faire venir son partenaire. Le dossier est refusé, le pacte colombien n’est pas reconnu par le Canada. « Lien de parenté, travail effectué, condition économique, voyages effectués, rien ne satisfaisait l’Ambassade, explique Diego, il y avait 5 critères de refus, on en cochait 4 ».
Il faudra attendre 7 ans, le 18 janvier 2017, pour que les deux hommes se retrouvent enfin au Québec.
Une bataille administrative
Entre Montréal et Bogotá, la première année se passe à distance. « Skype était notre plus grand allié », ironise Diego. Mais en réalité, le poids de la solitude, ajouté aux difficultés de l’immigration, est bien lourd à porter. « Je me suis senti comme si je nageais à contre-courant, je devais faire de gros efforts pour l’adaptation linguistique, car je faisais des études doctorales en français et en anglais, je ne connaissais quasiment personne à Montréal, je n’avais pas de conjoint, pas de famille et très peu d’argent », se remémore-t-il. Épisodiquement, Diego retourne en Colombie pour son travail de recherche sur les savoirs autochtones et la reconnaissance de leurs droits en Amazonie.
Au Québec, c’est pour ses propres droits qu’il doit batailler. « En 2012, je me suis renseigné pour postuler au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), mais comme je vivais séparé de mon conjoint resté en Colombie, notre lien n’aurait pas été reconnu. Il fallait nous marier, ce qui n’était possible ni ici ni là-bas, puisque mon chum ne pouvait venir sans visa, on tournait en rond… ».
Puis, en 2013, l’État de New York, où habite le frère de Diego, reconnaît le mariage homosexuel. Profitant alors de facilités d’accès au visa américain, les deux hommes se marient le 31 décembre 2013. Impossible toutefois de rentrer ensemble au Canada. L’un repart ainsi en Colombie, tandis que l’autre rejoint le Québec. Mais cela leur permet toutefois d’être admissibles au PEQ, et ils se trouvent enfin en mesure de demander le CSQ, avant d’entamer la procédure de résidence permanente au fédéral.
« En janvier 2016, j’ai eu une offre intéressante pour travailler en Colombie dans le domaine des droits humains ». Diego prend alors la décision de retourner dans son pays d’origine. « C’était très dur, ça mettait en suspens cette décision de vivre au Canada qui faisait partie de mes rêves, mais ça nous permettait aussi d’attendre ensemble les papiers », justifie-t-il. Le 18 janvier 2017, le couple se présente ensemble à la frontière, munis de leurs papiers : ils sont résidents permanents. « C’est sûr, c’était comme repartir à zéro. Mais j’avais plusieurs atouts dans mes bagages, désormais : un doctorat canadien, des expériences de travail dans des universités d’ici… La différence avec la première immigration, c’est que je me suis dit “je ne m’en vais jamais plus du Canada ! Je savais que c’était ici que je voulais vivre et m’enraciner” ».
La résilience dans l’action
Son adaptation au Québec, c’est notamment à sa persévérance que Diego la doit. « Les Colombiens ont une très forte capacité de résilience. Cette capacité de lutte pour faire les choses avec conviction, je la garde précieusement ancrée en moi ». De son nouveau pays, il adopte spontanément la culture du bénévolat. « C’est fascinant la générosité dont les gens font preuve, ils s’engagent, prennent du temps pour aider les autres, s’investissent dans des causes sociales. Je pense que le Canada est un pays riche, car les gens sont généreux. » Il s’engage pour le Centre québécois de formation en droits humains. La cause des femmes, des personnes en situation de handicap, des autochtones, tout lui parle et fait résonance avec son travail de recherche sur les peuples autochtones en Colombie. « La façon de vivre un peu dans les marges en tant qu’immigrant, appartenant à une minorité sexuelle, et d’avoir dû me battre avec l’apprentissage des langues, tout ça m’a rendu plus conscient de ce que d’autres vivent, dans des situations pires que moi, et de ce que je peux faire pour qu’ils puissent aussi avoir accès à des choses auxquelles ils ont droit. »
Agir, c’est le cœur de son travail, qu’il s’agisse des 3 ans passés au Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) sur la question des droits humains et d’égalité de genre, ou de son récent poste comme conseiller en équité, diversité et inclusion à l’université d’Ottawa. Diego n’en oublie pas moins la Colombie, organise des levées de fonds, a participé à la création d’un programme pour appuyer des initiatives ciblant les femmes vénézuéliennes réfugiées en Colombie. « Je me sens plus fort émotionnellement pour pouvoir aider depuis le Canada. En Colombie, travailler sur les droits humains reste un travail à risques », rappelle-t-il.
Toujours un immigrant
Quand il se retourne sur le chemin parcouru, Diego voit une suite de batailles menées, mais aussi beaucoup de soutiens et d’alliés. « C’est ça qui m’encourage à penser que c’est possible de transformer les choses ». Lui qui, 11 ans après, se définit toujours comme un immigrant, fort de ses origines et représentant de ce Canada multiple, retient l’humilité comme grand apprentissage de son parcours d’immigration. « Cette humilité, c’est un élément important qu’il ne faut pas perdre, souligne-t-il. Parfois, en tant qu’immigrants, nous oublions d’où nous venons et que d’autres sont en train de vivre des épreuves que nous avons déjà traversées. Il faut faire en sorte que ce soit moins dur pour eux. » Et de noter combien, quand on est à deux dans la bataille, « on est incontestablement plus fort ».